LES VISAGES DE L'INSTITUT SE CONJUGUENT AU FÉMININ
À l’Institut de Myologie, future Fondation de Myologie, elles sont chercheuses, neurologue, psychologue ou kinésithérapeute. Toutes ont choisi de consacrer leur carrière aux maladies neuromusculaires, un domaine exigeant qui allie rigueur scientifique, engagement et accompagnement humain. La Journée Internationale du Droit des Femmes, le 8 mars, est l’occasion de mettre en lumière leur travail et leur regard sur la place des femmes en science et en médecine.
Capucine Trollet, directrice de recherche à l’INSERM, dirige l’équipe OPeRA sur la régénération musculaire. Elle insiste sur l’importance pour les chercheuses d’accéder aux postes à responsabilité et de gagner en visibilité :
« Les femmes sont bien représentées en biologie, mais plus on monte en responsabilité, plus elles sont rares. Il faut absolument encourager les femmes à prendre des postes à responsabilité et à s’affirmer. Plus il y aura de chercheuses visibles, plus les jeunes femmes pourront se projeter et s’autoriser à poursuivre des carrières scientifiques. »
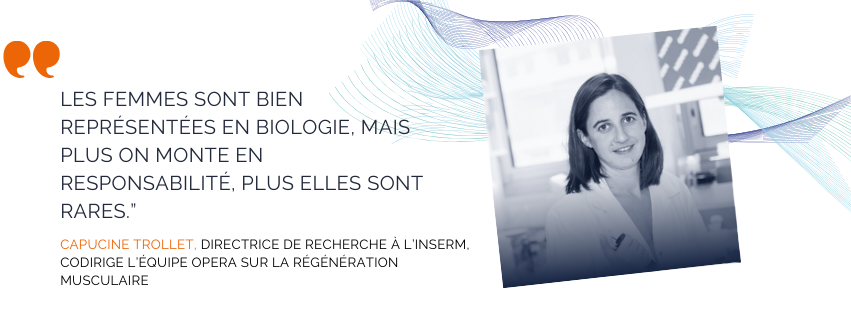 |
Elle évoque également Gillian Butler-Browne, qui, à l’époque où elle dirigeait le laboratoire de physiopathologie et thérapie des maladies du muscle strié à l’Institut de Myologie, a joué un rôle essentiel dans la structuration de la myologie en France et dans la formation de nombreuses chercheuses et chercheurs :
« Gillian Butler-Browne a joué un rôle essentiel dans mon parcours. Elle a dirigé notre laboratoire avec exigence et bienveillance. Elle a toujours travaillé dans une dynamique de partage des connaissances et de transmission. Son leadership est un modèle. »
Marcela Gargiulo, psychologue clinicienne et responsable de l’équipe des psychologues, voit chaque jour des parents, et notamment des mères, faire face à la maladie de leur enfant avec une force impressionnante.
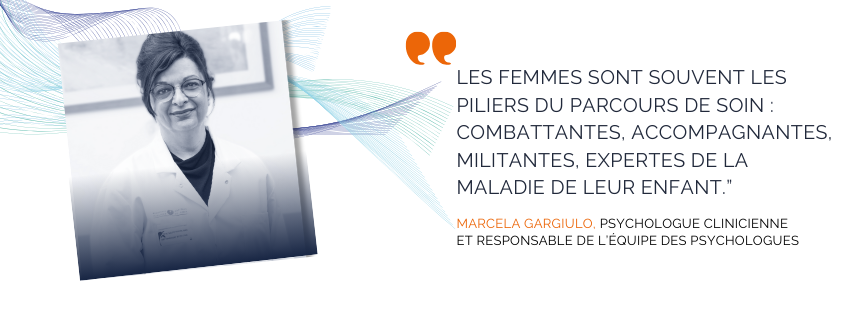 |
« Si je devais rendre hommage à une figure féminine, ce serait aux mères d’enfants atteints de maladies neuromusculaires. Elles sont combattantes, accompagnantes, militantes. Elles influencent la prise en charge et même la recherche. Ce sont elles qui alertent sur les besoins non couverts, qui interpellent les soignants, qui se battent pour que leur enfant bénéficie des meilleures prises en charge. Beaucoup deviennent expertes de la maladie et contribuent à faire évoluer notre compréhension des pathologies. »
Elle rappelle que, même dans un domaine comme la psychologie où les femmes sont majoritaires, elles restent encore sous-représentées aux postes décisionnels :
« La psychologie est une discipline largement féminine, mais l’accès aux postes de responsabilité et à la reconnaissance institutionnelle reste un combat. Il faut continuer à travailler pour que l’expertise des femmes soit pleinement reconnue. »
Audrey El Kaïm, kinésithérapeute spécialisée en neuromyologie, pointe les inégalités qui persistent dans la prise en charge des patientes :
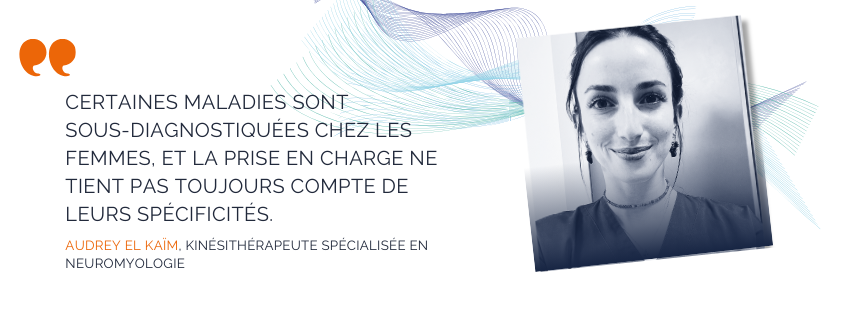 |
« Longtemps, la médecine a été pensée pour un corps masculin. Certaines maladies sont sous-diagnostiquées chez les femmes, et la prise en charge ne tient pas toujours compte de leurs spécificités. Ce n’est pas une question secondaire, c’est un enjeu majeur. Les femmes ont souvent des parcours de soin plus longs, plus complexes, parfois marqués par un retard de diagnostic. La recherche médicale doit intégrer ces différences. »
Elle tire aussi son inspiration des patientes qu’elle accompagne, dont certaines font preuve d’une capacité d’adaptation remarquable :
« J’ai une patiente, en particulier, qui transforme chaque difficulté en opportunité. Quand sa capacité respiratoire a diminué, elle s’est mise au chant. Pour sa mobilité, elle a adopté un chien d’assistance. Quand elle a voulu refaire du ski après vingt ans d’arrêt, elle s’est rapprochée d’une association de Handiski. Elle refuse de se laisser définir par sa pathologie. Son approche est une véritable leçon. »
Tanya Stojkovic, neurologue et coordinatrice du centre de référence des maladies neuromusculaires, souligne les obstacles qui freinent encore les carrières féminines en médecine :
« Le problème du congé maternité est un bon exemple : une femme qui s’arrête est ralentie, alors que ses collègues masculins continuent leur progression. Cela demande de rattraper, parfois de lutter deux fois plus. »
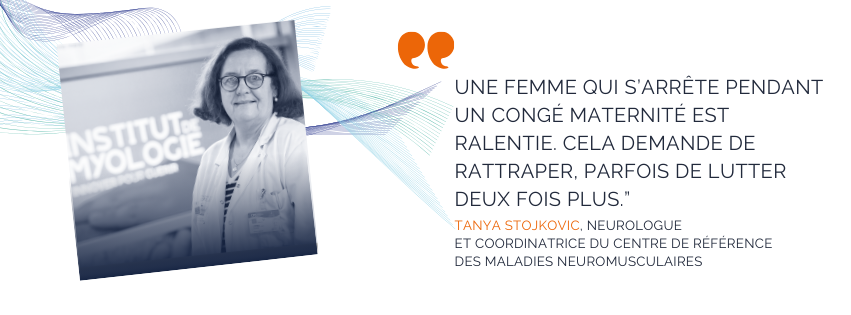 |
Elle cite une figure qui l’a profondément marquée :
« Simone Veil, sans hésitation. Son courage est un modèle de ténacité et de détermination. Dans le domaine médical, Anita Harding a également été une inspiration. Elle a profondément contribué à la compréhension des maladies du nerf périphérique. C’était une chercheuse brillante, avec une capacité d’analyse hors du commun. »