LES VISAGES DE L'INSTITUT : CAPUCINE TROLLET
Capucine Trollet est directrice de recherche à l’INSERM et dirige l’équipe OPeRA (Orchestration cellulaire et moléculaire en régénération musculaire, pendant le vieillissement et en pathologies) au Centre de Recherche en Myologie de l’Institut de Myologie, à Paris. Son équipe étudie les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la régénération musculaire humaine, notamment dans des contextes tels que le vieillissement et des dystrophies musculaires comme la dystrophie musculaire oculopharyngée (DMOP) et la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).
Leur objectif est en particulier de comprendre comment les cellules interagissent pour orchestrer la régénération musculaire et explorer des approches thérapeutiques pour les patients.
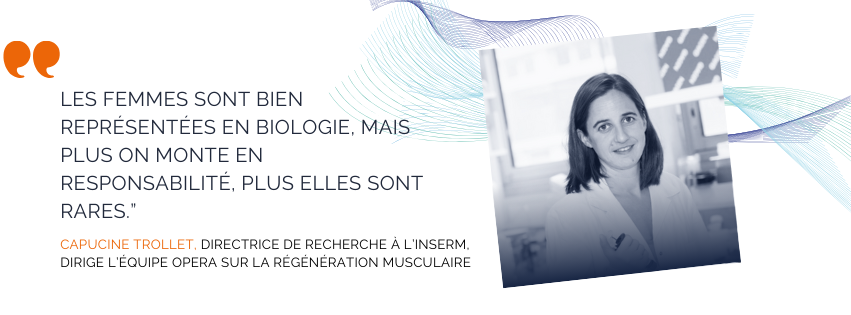 |
Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours vers la myologie ?
« Je suis directrice de recherche et je dirige l’équipe Opéra, qui travaille sur la régénération musculaire. Mon parcours a été assez sinueux. Initialement, j’étais intéressée par la physique et la chimie, ce qui m’a menée vers une formation d’ingénieur en génie chimique. Mais c’est en découvrant la biologie et la biotechnologie que j’ai réellement trouvé ma voie. J’ai intégré un cursus en biologie au Muséum national d’histoire naturelle avant d’effectuer une thèse sur la thérapie génique appliquée au muscle. Ce sujet m’a passionnée, car il répondait à mon envie d’allier compréhension fondamentale et applications concrètes. Après un post-doctorat à Londres où j’ai travaillé sur des approches de thérapies géniques pour traiter des maladies musculaires rares, j’ai rejoint mon équipe actuelle pour approfondir l’étude de la régénération musculaire et de ses dérèglements. »
Qu’est-ce qui rend cette spécialité essentielle et passionnante ?
« Le muscle est un organe fascinant qui représente environ 40 % du poids corporel. Il ne sert pas seulement à se mouvoir, mais joue un rôle crucial dans des fonctions vitales comme la respiration et la déglutition. Ce qui me passionne, c’est la complexité de son fonctionnement : il est capable de se régénérer grâce à une coordination fine de différents types cellulaires. Mais quand cette orchestration est perturbée, que ce soit par une mutation génétique ou un phénomène inflammatoire, cela peut conduire à des perturbations graves comme la fibrose. Comprendre ces mécanismes permet d’identifier des pistes thérapeutiques pour restaurer un muscle fonctionnel. C’est un défi immense mais extrêmement motivant. »
Quels sont les défis et avancées majeures que vous anticipez pour l’avenir de la myologie ?
« Les défis sont nombreux. D’abord, la complexité des maladies musculaires : certaines sont génétiques, d’autres inflammatoires, d’autres encore liées au vieillissement. Il est crucial d’identifier les points communs et les spécificités de chacune. Dans mon équipe, nous adoptons une approche transversale : par exemple, nous étudions la fibrose musculaire dans différentes maladies pour voir si des stratégies thérapeutiques peuvent être partagées. Un autre défi est de développer des thérapies combinées : traiter la cause de la maladie, mais aussi réparer les dommages existants. Enfin, un enjeu majeur est de mieux comprendre pourquoi certaines cellules musculaires résistent mieux que d’autres à la maladie, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles pistes de traitement. Mais le plus grand défi de la recherche reste le financement, je passe une grande partie de mon temps à chercher des fonds ! »
Y a-t-il une femme, dans votre domaine ou ailleurs, qui vous inspire particulièrement ?
« Oui, sans hésitation, Gillian Butler-Browne, qui a joué un rôle essentiel dans mon parcours. Elle est une chercheuse exceptionnelle, d’une immense rigueur scientifique, mais aussi une personne d’une grande humanité. Elle a longtemps dirigé notre laboratoire et a toujours eu une approche collaborative. Ce qui m’a toujours impressionnée chez elle, c’est son engagement envers la recherche et les jeunes chercheurs. Elle a su insuffler une dynamique de travail fondée sur le partage des connaissances et le respect de chacun. Elle n’a jamais cherché à se mettre en avant, mais son impact dans notre domaine est immense. C’est un modèle de leadership au féminin, qui montre qu’on peut diriger avec bienveillance et exigence à la fois. »
Pourquoi est-il important d’encourager davantage de femmes à s’engager dans la recherche et le domaine médical ?
« Parce que l’égalité entre hommes et femmes dans les carrières scientifiques n’est toujours pas acquise. Les femmes sont bien représentées en biologie, mais plus on monte en responsabilité, plus elles sont rares. Il faut absolument encourager les femmes à prendre des postes à responsabilité et à s’affirmer. Trop souvent, elles doutent de leurs compétences alors qu’elles sont tout à fait légitimes. Les stéréotypes de genre persistent et influencent les choix d’orientation, les opportunités et même les décisions de recrutement ou de promotion. Trop souvent, on pense encore que les hommes sont naturellement meilleurs dans ces domaines, ce qui freine les jeunes femmes dès le départ. Il est démontré que ces biais impactent la progression de carrière et maintiennent les inégalités. Il faut aussi des modèles. Plus il y aura de chercheuses visibles, plus les jeunes femmes pourront se projeter et s’autoriser à poursuivre des carrières scientifiques. Il est également essentiel de montrer qu’il est possible de concilier recherche et vie personnelle. J’ai moi-même trois enfants et cela ne m’a jamais empêchée d’être pleinement investie dans mon travail. Il faut déconstruire l’idée qu’il faut choisir entre les deux. Enfin, au-delà des carrières, il y a un véritable enjeu scientifique. Pendant longtemps, la recherche médicale a été menée principalement sur des hommes, ce qui a retardé notre compréhension de certaines maladies affectant spécifiquement les femmes. Avoir plus de chercheuses permet d’apporter des perspectives différentes, d’enrichir la recherche et de mieux répondre aux besoins de l’ensemble de la population. C’est à la fois une question d’équité et un enjeu pour une science plus juste et plus efficace. »
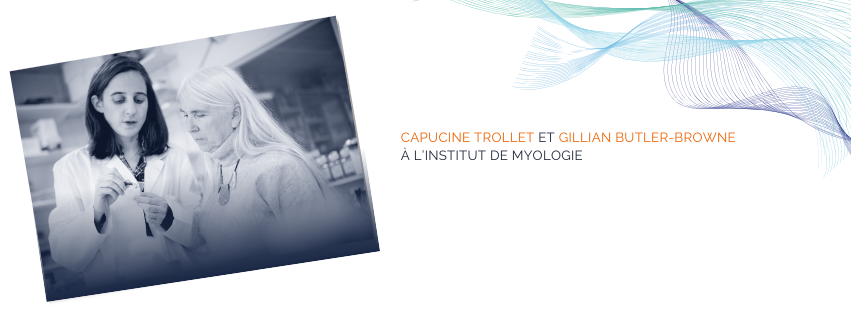 |