LES VISAGES DE L'INSTITUT : AUDREY EL KAÏM
Audrey El Kaïm est kinésithérapeute spécialisée dans les maladies neurologiques et neuromusculaires. Elle partage son temps entre la recherche au sein du Laboratoire de Physiologie et d'Évaluation Neuromusculaire de l'Institut de Myologie et la pratique clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en post-réanimation neurologique. Elle porte un regard global sur ses patients intégrant leur qualité de vie, leur autonomie et même leur bien-être intime.
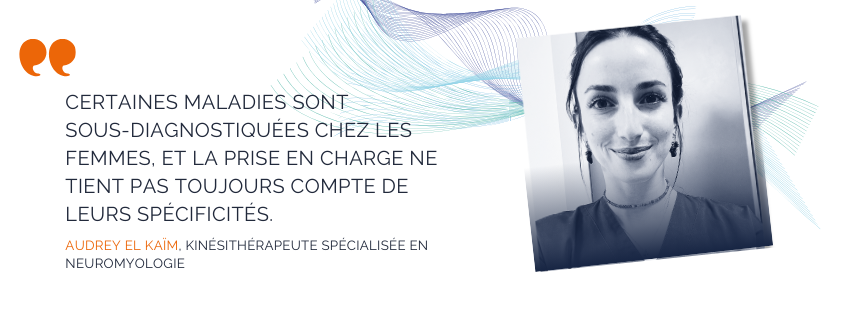 |
Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours vers la myologie ?
Je suis kinésithérapeute depuis presque cinq ans. Mon intérêt pour la neurologie et les pathologies neuromusculaires s’est affirmé dès mes études à l’EFOM Boris Dolto. Après une expérience en médecine interne et gériatrie, j’ai eu l’opportunité d’entrer à l’Institut de Myologie, un peu par hasard, à l’occasion de mon mémoire de fin d'études. J’ai alors intégré une double activité, entre la recherche et la clinique, qui m’a permis d’approfondir ma compréhension des maladies neuromusculaires tout en conservant un contact direct avec les patients. J’ai également poursuivi ma formation avec un master en santé publique et en biostatistiques appliquées à la recherche biomédicale afin d’approfondir mes connaissances sur l’évaluation des traitements et des innovations médicales. Depuis septembre 2024, je me forme également en sexologie clinique et sexothérapie à la faculté de Cochin, car je suis convaincue que la santé intime fait partie intégrante du bien-être global.
Qu’est-ce qui rend cette spécialité essentielle et passionnante ?
La myologie est un domaine fascinant car elle se situe à l’interface entre la recherche fondamentale, la clinique et l’innovation thérapeutique. Les maladies neuromusculaires sont souvent rares, évolutives et handicapantes, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire rigoureuse et adaptée à chaque patient. Ce qui rend cette spécialité essentielle, c’est l’impact direct que les avancées scientifiques peuvent avoir sur la qualité de vie des patients. Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est d’aborder la personne dans sa globalité. Les maladies neuromusculaires impactent bien plus que la force musculaire : elles affectent la mobilité, l’autonomie, la vie sociale et intime. J’ai souvent constaté, au fil des échanges avec mes patientes, que ces dimensions sont encore trop peu prises en compte dans le parcours de soin. Par exemple, certaines de mes patientes souffrant de myotonie m’ont confié rencontrer des difficultés dans leur vie intime, ce qui n’avait jamais été abordé dans leur parcours de soin. En les écoutant, j’ai pris conscience de la nécessité de leur offrir un accompagnement spécifique.
Quels sont les défis et avancées majeures que vous anticipez pour l’avenir de la myologie ?
Les avancées en thérapies géniques ont ouvert de réelles perspectives pour les maladies neuromusculaires, mais elles restent encore trop peu accessibles. Mais au-delà des traitements, de nombreux patients se heurtent à un manque de kinésithérapeutes formés en dehors des centres spécialisés. Beaucoup se retrouvent sans suivi adapté, alors même que ces pathologies nécessitent un accompagnement régulier. Démystifier ces maladies auprès des kinés en ville, c’est essentiel pour briser les appréhensions, favoriser une meilleure prise en charge et permettre aux patients de bénéficier d’une rééducation adaptée pour mieux vivre avec leur maladie.
Y a-t-il une femme, dans votre domaine ou ailleurs, qui vous inspire particulièrement ?
Dans le domaine médical et scientifique, de nombreuses femmes m’inspirent, qu’il s’agisse de chercheuses ou de cliniciennes engagées, qui allient expertise et bienveillance pour offrir les meilleurs soins à leurs patientes et patients. Mais au-delà des soignantes, celles qui m’impressionnent le plus au quotidien sont les patientes elles-mêmes, par leur incroyable capacité d’adaptation face à la maladie. La première personne qui m’est venue à l’esprit est une patiente qui ne cesse de trouver des solutions à chaque difficulté que lui impose sa pathologie.
Lorsque ses capacités respiratoires ont diminué, elle s’est mise au chant pour travailler son souffle. Pour améliorer son périmètre de marche, elle a adopté un chien d’assistance, qui la motive à sortir chaque jour et l’aide à prendre les transports en toute confiance. Elle rêvait de refaire du ski après vingt ans d’arrêt ? Elle a contacté une association de handiski et s’est lancée. Cette façon d’aborder chaque difficulté avec optimisme et créativité m’inspire profondément et me rappelle combien la force de celles et ceux qui font face à la maladie dépasse bien souvent ce que l’on imagine. Elle m’a aussi permis de m’ouvrir à d’autres aspects de la prise en charge, de mieux comprendre les besoins au-delà des soins médicaux, et de voir combien une approche humaine et adaptée peut faire la différence.
Pourquoi est-il important d’encourager davantage de femmes à s’engager dans la recherche et le domaine médical ?
L’inclusion des femmes dans la recherche et la médecine est un enjeu double : il s'agit à la fois d’encourager davantage de femmes à intégrer ces métiers et à accéder à des postes de décision, mais aussi de veiller à ce que les spécificités féminines soient mieux prises en compte dans les essais cliniques et la recherche, afin d’éviter des biais aux conséquences potentiellement graves. Comme l’illustre "Mauvais traitements" de Delphine Bauer, la sous-représentation des femmes dans les essais cliniques a conduit à des scandales médicaux, des traitements inadaptés et des diagnostics tardifs. Longtemps, la médecine a été pensée pour un corps masculin standardisé, négligeant des réalités pourtant vitales. Par exemple, les symptômes de l’infarctus du myocarde diffèrent souvent chez les femmes, retardant leur prise en charge, alors même qu’il représente la deuxième cause de mortalité féminine. La "taxe rose" ou l’oubli des spécificités féminines dans le développement des médicaments sont d’autres exemples de ces inégalités systémiques. Encourager davantage de femmes en recherche et en médecine, c’est garantir des avancées qui bénéficient à toute la population. C’est aussi briser les stéréotypes et favoriser l’émergence de modèles inspirants pour les générations futures.
